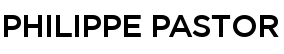Nicolas Charlet
Paris, le 1er juillet 2003
Il est devenu peintre à quarante ans. Déjà sa vie, il la flambait, ivre de beauté et de volupté. En réalité Philippe Pastor a toujours été peintre. Cette évidence, écrite à l’encre rouge dans son regard vert, ne laisse personne indifférent. Ses mains, colorées de bleu, terre de sienne ou orangé, en disent long. Celui-là vit la peinture comme d’autres vivent une grande histoire d’amour. Il en a fait sa vie, son histoire. A Saint-Tropez, on le connaît bien ce grand séducteur que le soleil et les femmes semblent avoir apprivoisé. Petit Prince venu d’une autre planète, Monaco, il peint avec un acharnement titanesque dans l’indifférence générale. Seuls quelques amis ont vu. Ce qu’ils ont vu n’a rien d’ordinaire.
Quand on arrive chez lui, au bout de la route, juste avant la mer, on découvre un atelier ouvert et des toiles en quantité, posées sur des tables improvisées dans le jardin, en plein soleil. Ainsi, dit-il, la couleur crame. Sous l’action de la chaleur, le pigment est littéralement saisi. Mêmes les coulures connaissent la soif d’un soleil de plomb. Sous le auvent, sont soigneusement stockées les dernières peintures, sur toile ou papier -de la plus belle qualité-. Tout près, l’atelier sans mur ressemble à un souk marocain : partout des sacs ou des petits pots de pigment. L’échantillonnage des couleurs est une invitation au voyage. Dans un bocal, des boules d’outremer ramenées du désert. Au sol, des bidons d’un liant laiteux, une caisse de pinceaux, des mixtures de toutes sortes qui dégagent parfois des odeurs fortes. Pastor suit le rythme du soleil. Il rejoint son atelier aux moments de douceur : au petit matin et au soir du jour. Entre les deux, il navigue en mer sur un bateau rapide qui porte le nom de sa fille, Victoria, et incarne ses rêves de liberté.
La peinture se fait dans ce climat de sérénité qui n’est pas sans rappeler la joie de vivre de Matisse. Un même idéalisme l’habite. Très concentré mais détendu, Pastor écoute inlassablement l’invitation au voyage de Léo Ferré. Cette voix inspirée, parfois déchirante, sur fond de piano, le plonge dans une douce rêverie. « C’est de la poésie… », souffle le maître. L’univers de Pastor est là, entre la spontanéité d’une expression émerveillée et la révolte d’une humanité blessée. Une fois, les deux hommes se sont rencontré, au hasard d’une rue. Le monsieur a dit au petit bien propret, « …pour toi c’est pas gagné, tu as du chemin à faire… » Sans doute a-t-il compris le message, lui qui s’est éloigné des affaires pour se consacrer à sa peinture. En effet, il peint avec une étrange confiance, l’enthousiasme et la foi d’un bâtisseur.
Le calme de cet homme au regard vert contraste avec la violence des premiers coups de crayon sur le papier. Le jaillissement de la forme se fait dans la douleur. On pense au dessin haché de Giacometti avec, en plus, la fureur d’un Camille Bryen. Les crayons cassent, la ligne continue. Elle file à la vitesse de l’éclair dans tous les sens, comme dictée de l’intérieur. Cette griffure ininterrompue, à la mine de plomb, au fusain ou à l’encre de chine, se situe au minimum de la maîtrise, dans l’espace poétique du dessin automatique. Parfois, l’amplitude du geste est volontairement démultipliée au moyen d’un roseau trempé dans l’encre de Chine, lointain souvenir de Matisse à Saint-Paul-de-Vence. La moindre vibration se répercute comme une onde au bout du bâton. La forme arrachée à la blancheur du papier possède alors l’authenticité d’une empreinte, une sorte d’électrocardiogramme à visage humain.
Ce premier jet, en tension, est tempéré par le plaisir de la couleur, une matière aqueuse versée avec générosité. Le peintre fait ses mélanges d’instinct, sans mesurer ni quantifier. Il va vite mais ne se précipite pas. Il accueille avec le sourire l’apparition de la couleur, un petit miracle. Là encore, il goûte aux joies du hasard. Ses mixtures à base de pigments naturels réservent des surprises. De quelques minéraux verts, il fait un violet somptueux. Et si apparaît un outremer profond, il exploite l’imprévu. De la même manière, il s’approprie les accidents : coulures, tâches ou craquelures.
La séance de travail est rythmée : d’abord des œuvres sur papier puis une ou plusieurs toiles, allongées sur une planche reposant sur des tréteaux. La belle blanche reçoit le dessin des visages, puis celui des corps tout entier, dénudés jusqu’à l’extrême de la chair. Quand vient la peinture, le geste se fait sensuel. Pastor répand la couleur, l’éponge, la caresse. Il s’en met plein les doigts, la dépose délicatement avec un pinceau trempé ou une éponge improvisée avec du papier absorbant. La matière dégoulinante est tamponnée généreusement. De ce contact naît, à nouveau, une empreinte.
La spontanéité de ce mode de création implique une technique libre. Rien est figé. Le dessin automatique n’enferme pas la forme, ne cristallise pas la composition ; la couleur, en partie aléatoire, ne remplit pas les vides, ne réduit pas la ligne à un cerne. La ligne et la couleur ont leur vie propre. Pour cela Pastor n’hésite pas à couvrir et à découvrir le dessin en une succession alternative de coulées et de retraits. Ce rythme vital, le flux de l’inspiration-expiration, donne une dimension ontologique au processus de création. Concrètement, la coulée de peinture, versée, tamponnée ou tracée, est directement suivie d’une soustraction de liquide. Le peintre déroule délicatement sur le support mouillé par les lavis pigmentés un rouleau de papier absorbant. Il tamponne, passe sa main doucement, modère la pression aux points de contact. Si besoin, il réitère l’opération, avec la volonté de maîtriser son geste. Le papier, type Sopalin de grand format, boit la matière colorée, s’en imbibe en l’espace d’un instant. Alors le dessin réapparaît. De l’œuvre, il reste, une fois encore une empreinte.
Dans les premiers temps, les couleurs de Pastor, directement issues des pigments du Maroc, étaient éclatantes. Surtout les rouges et les bleus. Les « Couples de Saint-Tropez », tout en rondeur, avaient la délicatesse du travail fini. Leur tonalité chatoyante était conforme à la tendresse amoureuse des corps inscrits dans des cœurs. Puis, le beau dessin comme la belle couleur ont pris une tournure expressionniste avec la série des « Gueules ». En abandonnant les effets décoratifs, l’artiste allait découvrir les ressorts des lavis, des encres, des couleurs innommables. Les tons de terre et de sang, les bleus noircis, se sont progressivement substitué aux couleurs pures. Depuis quelques mois, ces tonalités terriennes, dans la gamme des ocres et des noirs, ouvrent de nouvelles perspectives à Pastor. Toujours à l’affût d’une possible progression de son œuvre, il explore désormais la chair sans concession.
En atteste, la réitération du dessin à même la couleur. Cette quatrième opération, après le dessin automatique, la déposition de la matière colorée puis son absorption, marque le retour du trait dans une déflagration gestuelle en fort contraste avec les deux opérations précédentes. Le dessin dans la couleur se fait parfois au fusain et plus souvent par grattage avec le manche d’un pinceau. Les effets obtenus sont significatifs d’une volonté de maintenir une tension entre la forme humaine et l’informe. Peut-être Pastor a-t-il vu ce tableau de Rebeyrolle, à la fondation Maeght, où l’on peut apercevoir la trace bouleversante d’une main ensanglantée dans un espace apocalyptique ? On pense aussi inévitablement aux pâtes épaisses d’Anselm Kiefer ou encore aux Otages de Fautrier.
Le tour de force de ce langage, puissant et sensible, n’est pas d’ordre purement technique. Aucune virtuosité, aucune confusion du mouvement et de la vitesse. On est loin de l’abstraction gestuelle de Mathieu et du misérabilisme de Buffet. Il en reste pourtant quelque chose, avec beaucoup plus de fluidité, de tendresse et d’humour. Le tour de force de ce langage est à chercher du côté de l’empreinte. J’entends par là moins une technique qu’une éthique. L’empreinte est partout présente dans la peinture de Pastor. Les trois premiers temps du processus créatif, le dessin, la couleur, le buvard, correspondent à autant de types d’empreintes : celle de l’inconscient, de la matière, du regard. L’automatisme du dessin est une manière de saisir l’inconscient dans l’impulsion d’une pensée devenant forme, le tamponnage de la couleur liquide née d’une étrange alchimie est un moyen archaïque de se remémorer les marques de la matière primordiale, la soustraction par impression est la métaphore du regard. Ce dernier capte une part de réel quand il se pose sur l’objet. Le réel n’existe pas indépendamment de ce regard. Son existence est soumise au flux de l’échange que Pastor imagine à travers le mouvement respiratoire de la couleur, déposée puis absorbée. Le quatrième temps de la création, celui du grattage, inverse les précédents. Une fois creusé, le tableau devient le moule, c’est-à-dire la matrice de la forme humaine émergeant du poïen originel. N’est ce pas le sens de cette déclaration : « En fait, je peins le fond des personnages, ce qu’il en reste quand ils sont passés dans la rue » ? Ce fond qui reste dans la mémoire est un moule pour l’imagination.
On l’aura compris, cette peinture procède d’une opposition des contraires. La tension de la forme et de l’informe est aussi celle de la tâche et de la trace. Pastor en joue habilement, laissant les coulures et les effets d’impression à leur destin expressif, comme si la matière parlait d’elle-même. Il faut voir ce peintre s’émerveiller d’une configuration imprévue des masses ou d’une étrange cristallisation des pigments naturels avec le temps. Pastor joue tellement du hasard qu’il a appris à maîtriser sa peur. Il fait des expériences, il prend des risques. Sa méthode implique une belle confiance. Aussi, est-il conscient de la nécessité de faire, au risque de faire mal. Dès lors qu’il ne craint plus l’échec, il réussit des tableaux.
Toute la difficulté est de parvenir à exprimer la présence dans l’absence. Ces personnes anonymes croisées dans la rue ou ces alcooliques mondains attablées à la terrasse d’un café tropézien sont très peu caractérisés. Au mieux, on perçoit des bijoux, une chevelure féminine, une manière de se tenir. Néanmoins le lien à la réalité iconique reste ténu. Pastor use de moyens autrement efficaces. A la manière de Tapiès, il marque la présence d’une croix. Le nez tranche le visage à la verticale et le chapeau dans l’autre sens. Ces visages en croix sont flanqués de deux trous rouges, noirs ou bleus à la place des yeux. « J’ai enlevé la bouche parce que tous ces gens ne parlent pas », explique le peintre. Sont-ils morts-vivant ? Pétrifiés dans leur solitude, à-demi écrasés sur la toile, ces hommes en viennent à ressembler à des squelettes. Les corps en fer à cheval sont striés d’horizontales que la ligne des épaules rend oppressantes. La possible disparition de la forme et du sujet dramatise leur existence. A bien des égards, ce graphisme aiguë, ces couleurs innommables et cette composition en croix amplifient le sentiment de présence.
Dans le même esprit, Pastor démultiplie parfois la présence par une composition en frise. Les personnes anonymes, vues de face, sont alignées en rang serré sur un fond blanc, tel un mur. Tout cela ressemble à une exécution sommaire, comme le laisse supposer cette encre sanguinolente le long des corps.
Mais le drame qui se joue dans l’œuvre de Pastor n’est pas forcément triste. Ce drame de l’existence crée des situations épiques. La mort et le silence croisent la drôlerie et la légèreté. Quelques personnages tout en longueur ont des allures de Don Quichotte. D’autres tiennent du clown ou du pantin. On peut voir aussi des cowboys, un pirate, un amiral… Libre à chacun de reconnaître ces visages. Le plus frappant, peut-être, est l’ambivalence des sentiments que renvoient les nombreux couples de Pastor. Sont-ils tristes ou heureux ? Leur solitude a-t-elle eu raison de leur union ? Que reste-t-il de leur amour ? Le peintre parle volontiers de l’isolement des êtres mais on repère bien souvent de la tendresse. Une inclinaison de la tête suffit ou encore une épaisse ligne horizontale joignant les épaules d’un couple solide.
D’autres fois, les corps se confondent, en viennent à ne former plus qu’un. Corps bicéphale en signe d’une gémellité fondamentale : tout homme est à la fois unique et universel. La dualité de l’être, le moi et l’autre, hante l’univers de Pastor. Son changement de vie, des affaires à la peinture, explique en partie ce questionnement existentiel. Mais le problème est plus profond. Pastor est en quête d’une beauté idéale qu’il imagine en l’autre, la femme, alors qu’elle est en lui. Cette beauté intérieure dépasse toute extériorité. En définitive, la rencontre du je et du double se joue dans ce regard vert que le soleil et les femmes ont apprivoisé.
Nicolas Charlet
Paris, le 1er juillet 2003